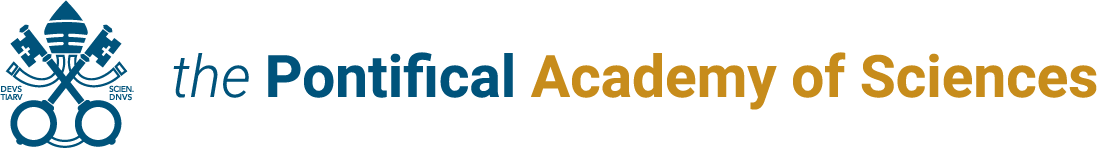La moitié des enfants du monde souffrent actuellement d'une école de qualité insuffisante ou ne sont pas scolarisés, dans un monde qui est affecté par des problèmes sérieux de développement durable. Cette situation préoccupante demande une attention urgente, tournée vers le long terme. Investir suffisamment dans l'éducation peut paraître lourd, mais les coûts de l'ignorance sont beaucoup plus élevés. Le futur de notre société globalisée en dépend. Partout dans le monde, les enfants doivent être inclus dans l'école et préparés aux tâches futures qui les attendent.
Cette Conférence a été bâtie sur l'évidence, que donne la science, d'un impact humain sur le climat, et également sur les crises environnementales qui affectent les habitants de notre planète - les plus vulnérables étant ceux qui vivent dans une pauvreté extrême et tout particulièrement leurs enfants. Le but de cette Conférence fut de définir un ensemble de recommandations ciblées, pouvant être mises en oeuvre et concernant l'éducation à l'école – l'inclusion de tous les enfants étant le souci principal. Ainsi cette Conférence a concerné l'enfance, les droits des enfants, l'aide aux professeurs, la justice et la responsabilité inter-générationnelle.
Cette Conférence et ses conclusions reposent sur des déclarations antérieures faites par les Académies pontificales [1]. Elle reflète également les principes énoncés dans les Objectifs du Développement Durable des Nations unies (SDG), particulièrement l’Objectif #4 portant sur l'éducation universelle. De façon significative, la Conférence trouva une grande inspiration dans la Lettre encyclique du Pape Francis Laudato Si’. Sur la sauvegarde de la maison commune[2], qui fait appel à " une éducation et spiritualité écologiques" (2015).
En 2016 dans le monde entier 125 millions de jeunes[3] (âgés de 0 à 15 ans) n'ont pas accès à l'école ou aux structures de petite enfance. Un milliard de jeunes vivent dans la pauvreté – avec une école insatisfaisante et un manque d'
... Read allLa moitié des enfants du monde souffrent actuellement d'une école de qualité insuffisante ou ne sont pas scolarisés, dans un monde qui est affecté par des problèmes sérieux de développement durable. Cette situation préoccupante demande une attention urgente, tournée vers le long terme. Investir suffisamment dans l'éducation peut paraître lourd, mais les coûts de l'ignorance sont beaucoup plus élevés. Le futur de notre société globalisée en dépend. Partout dans le monde, les enfants doivent être inclus dans l'école et préparés aux tâches futures qui les attendent.
Cette Conférence a été bâtie sur l'évidence, que donne la science, d'un impact humain sur le climat, et également sur les crises environnementales qui affectent les habitants de notre planète - les plus vulnérables étant ceux qui vivent dans une pauvreté extrême et tout particulièrement leurs enfants. Le but de cette Conférence fut de définir un ensemble de recommandations ciblées, pouvant être mises en oeuvre et concernant l'éducation à l'école – l'inclusion de tous les enfants étant le souci principal. Ainsi cette Conférence a concerné l'enfance, les droits des enfants, l'aide aux professeurs, la justice et la responsabilité inter-générationnelle.
Cette Conférence et ses conclusions reposent sur des déclarations antérieures faites par les Académies pontificales [1]. Elle reflète également les principes énoncés dans les Objectifs du Développement Durable des Nations unies (SDG), particulièrement l’Objectif #4 portant sur l'éducation universelle. De façon significative, la Conférence trouva une grande inspiration dans la Lettre encyclique du Pape Francis Laudato Si’. Sur la sauvegarde de la maison commune[2], qui fait appel à " une éducation et spiritualité écologiques" (2015).
En 2016 dans le monde entier 125 millions de jeunes[3] (âgés de 0 à 15 ans) n'ont pas accès à l'école ou aux structures de petite enfance. Un milliard de jeunes vivent dans la pauvreté – avec une école insatisfaisante et un manque d'attention à la petite enfance –. Ils ont des résultats scolaires de plusieurs années en retard par rapport aux enfants d’âge comparable, étudiant dans des contextes plus favorables. Les 60 millions de réfugiés – leur nombre a doublé dans les cinq dernières années – rencontrent des difficultés extrêmes pour l'éducation de leurs enfants. Les enfants d'autres migrants par force – provoqués par exemple par des changements environnementaux et en nombre croissant – sont également une préoccupation. Les impacts climatiques et les guerres aggraveront ces tendances migratoires. Elles demandent d'agir à la fois dans les pays en développement et dans les pays développés. Dans 14 sur 29 de ces derniers, les inégalités dans l'éducation ont récemment augmenté.[4]
Considérant ces immenses défis de l'avenir, le but principal est que chaque enfant puisse accéder aux connaissances, développer ses compétences, la confiance en soi, ainsi que l'espérance dans des solutions possibles et humaines. Quand ces enfants deviendront adultes, ils seront alors capables de construire une société globale qui respecte la personne humaine et la Terre, qui cultive l'empathie et la raison, qui reconnaisse les dimensions spirituelles et holistiques de chaque individu. L'éducation, forte des composantes éthiques et morales qui la constituent, doit répondre à ces défis de façon responsable, avec deux mandats impératifs et urgents :
La justice dans l'accès à une éducation de qualité. Une école inclusive doit être implantée, tout particulièrement pour les enfants marginalisés, les réfugiés et les migrants par force. Ceci implique une mobilisation internationale, une coopération globale et l'attention des gouvernements aux évolutions nécessaires.
Des objectifs d'apprentissage pour tous les étudiants. Globalement, au Nord autant qu’au Sud, des programmes académiques de qualité doivent s’engager pour implanter des curricula et une formation des professeurs qui se soucient de l'apprentissage d'un développement durable. Ceci implique la compréhension des enjeux climatiques, le développement de solutions innovantes, une appréciation croissante de notre maison commune, et des changements de comportement en faveur de choix de consommation responsables. Il est impératif que les enfants soient encouragés à cultiver leur amour naturel pour les habitants de notre planète et une attention à la planète elle-même.
Outre ces objectifs fondamentaux, trois thèmes essentiels émergent de la Conférence. Les participants pressent les autorités de l'éducation et toutes les parties prenantes de les mettre progressivement en oeuvre.
1. Un nouveau paradigme pour l'éducation. Dans tous les secteurs de l'éducation, il faut concevoir un nouveau cadre de curriculum, qui promeuve l'éducation concernant les perspectives de la vie et de l'histoire humaine sur la Terre, ainsi qu'une compréhension des questions globales. Ceci doit simultanément communiquer les connaissances et les moyens pour agir localement, aussi bien que les valeurs morales et l'importance d'un engagement communautaire. Une éducation interdisciplinaire et une prise de conscience, adéquate à chaque âge, sont nécessaires afin de d'enseigner les interactions complexes entre systèmes naturels et sociaux. L'éducation à la science et à la technologie joue ici un rôle critique, tant pour enseigner que pour apprendre comment réfléchir, raisonner et agir de façon durable.
2. Les technologies d'enseignement et d'apprentissage. Les nouvelles technologies de communication offrent des opportunités remarquables pour l'éducation, mais elles peuvent demeurer inefficaces si elles n’incluent pas des interactions intenses et substantielles entre élèves et professeurs. Dans ce nouveau cadre de pédagogie, la qualité de la préparation des professeurs et de leur développement professionnel, requiert une attention importante, un soutien et des efforts. En outre, les éducateurs doivent appliquer les résultats scientifiques disponibles, portant sur l'évolution biologique, les neurosciences, et les outils technologiques afin de mieux comprendre les étapes du développement de l'enfant et d'optimiser les processus d'apprentissage.
3. Les jeunes, agents du changement. Les enfants et les adolescents ne sont pas simplement des récepteurs de connaissances : ils doivent également être inspirés pour agir dans leur contexte local et concevoir des initiatives en faveur du développement durable dans leurs écoles et communautés. La jeunesse peut contribuer au changement, non seulement par des interactions constructives entre jeunes, mais également en influençant positivement les adultes. Les réseaux sociaux offrent des opportunités. L'éducation et la prise de responsabilité des filles sont essentielles pour contribuer à ce que les jeunes filles soient également des agents du changement.
Lors d'une session dédiée de la Conférence, l'Académie a invité dix-neuf adolescents et élèves, représentant douze nations, à présenter leurs vues sur l'éducation pour le développement durable. Leur présentation et les échanges avec les membres de l'Académie impressionnèrent fortement l'audience et ont contribué aux présentes Recommandations.
Ces Recommandations encouragent fortement les autorités éducatives, les responsables religieux et les autres parties prenantes à développer des relations plus fortes avec les secteurs qui suivent de façon à amplifier les changements et évolutions positives :
Scientifiques et universitaires. Une coopération étroite est nécessaire entre les systèmes éducatifs et les communautés scientifiques, puisque sciences et technologies sont essentielles dans le diagnostic des problèmes de développement ainsi que des facteurs de risque, et critiques dans la définition des actions nécessaires et possibles.
Leadership politique et financement. L'engagement collectif et les obligations morales autour de la maison commune Terre demandent un leadership global, de la générosité, le financement de projets innovants et des visions à long terme pour améliorer la condition humaine et l'environnement, tant pour les générations présentes que futures.
En coopération avec l'Académie pontificale des sciences, les soussignés consacreront leur énergie pour mettre en œuvre ces Recommandations par des actions diverses, particulièrement dans le contexte de la Lettre encyclique Laudato Si’, les objectifs de développement durable des Nations unies, et les conclusions de la conférence COP21 des Nations unies tenue à Paris.
Annexe détaillée, complétant les Recommandations
1. Un nouveau monde. Les changements majeurs et globaux posent un défi aux systèmes éducatifs, afin que qu'ils revoient leurs objectifs et qu'ils préparent leurs élèves à jouer des rôles actifs et responsables. Dans ce contexte du changement climatique, l'éducation doit s'affronter à la globalisation et à la compréhension entre cultures ; aux déséquilibres migratoires ; à l'évolution des modes de travail ; à la révolution numérique ; à l'urbanisation ; au changement du monde rural ; à la santé, la nourriture, l'eau et l'hygiène. Une éducation interdisciplinaire reconnaît le besoin d'éduquer la jeunesse aux interactions complexes entre les systèmes naturels et les systèmes sociaux, ce que l'Encyclique Laudato Si’ appelle une écologie intégrale.
2. Inclusion et pauvreté. L'enfance doit être redéfinie dans une perspective inclusive. Ces changements nécessaires de l'école doivent bénéficier à tous les enfants : familles brisées ou recomposées, fillettes, enfants de migrants (intra- ou inter-nationaux), réfugiés, victimes de trafic humain, handicapés, exclus ethniques, et tout enfant qui abandonne l'école. L'éducation seule n'éradiquera pas la pauvreté, mais elle est une composante essentielle de cette éradication.
- L'égalité entre genres dans l'éducation jouera un rôle efficace pour le bien-être économique et social, aussi bien que pour la transition démographique.
- L’éducation est inséparable des dimensions environnementales, économiques, sociales et culturelles. L'objectif de développement durable (SDG) #4 des Nations unies (éducation universelle) ne peut pas être séparé des autres objectifs, par exemple #10 (réduction des inégalités). L'UNESCO estime que des donneurs externes devraient offrir US$ 39 milliards/an pour que les pays à bas revenus soient capables de financer le SDG#4.
3. Une meilleure compréhension de l'apprentissage et de l'enseignement. Les capacités cognitives des êtres humains ont évolué biologiquement pour s'affronter à un monde simple et “pré-culturel“. L'espèce humaine a désormais besoin de s'adapter à des systèmes complexes et aux effets à long terme. La science fournit la connaissance d’outils qui peuvent inspirer l'éducation : sciences du cerveau et neurosciences ; accès global à l'information et nouveaux outils numériques ; éducation à la science fondée sur l'investigation. Ces éléments ont le potentiel de développer chez la jeunesse la confiance en soi, la créativité, et la pensée critique.
- Le potentiel des techniques d'information et de communication (TIC) dans l'éducation doit être bien davantage mis en oeuvre dans les pays à bas revenus, en s’appuyant sur un pilotage approprié, un financement et une coopération internationale.
4. Une nouvelle vision des curricula. Incluant la littéracie et la numéracie mais allant au-delà, les curricula doivent aider les élèves à comprendre la complexité des systèmes et les interconnexions de ce monde nouveau, et développer une conscience des défis auxquels les humains devront faire face à l'avenir.
- L’éducation à la science doit se développer partout dans le monde, particulièrement dans les pays à bas revenus, et les ressources nécessaires doivent être mobilisées, car l'éducation à la science est une condition préalable pour que les enfants d'aujourd'hui deviennent demain des acteurs responsables et efficaces.
- Puisque la littéracie interagit positivement avec le développement cérébral, il faut accorder beaucoup plus d'attention à l’amélioration de cette littéracie, de façon à accroître les capacités des générations futures à agir sur la complexité croissante des systèmes socio-écologiques.
- L'éducation des enfants doit être globale et holistique, incluant le corps, la pensée, l’esprit, la santé, le sens du bonheur et de la beauté. Elle vise autant les connaissances que les compétences.
5. Le rôle clé des enseignants. Les enseignants eux-mêmes ont besoin d'être tenus à jour des questions de développement durable et soutenable. Dans un monde intégré, des événements, se produisant en des lieux lointains et apparemment inaccessibles, peuvent avoir un impact global. Les enseignants ont besoin d'être préparés afin d’implanter de tels concepts dans leur enseignement, ils ont besoin d’être aidés par une formation initiale adéquate, un accompagnement et un développement professionnel au cours de leur carrière. Leur comportement doit être également exemplaire puisque donner aux jeunes un modèle est crucial dans l'éducation.
- Pour faciliter leur action, les enseignants doivent être mis en lien globalement dans le monde, afin de leur permettre d'échanger des expériences et des ressources, et de développer leur confiance dans la capacité des jeunes. Des plates-formes IT, capables de collecter systématiquement et de répandre des exemples d'éducation au développement durable, ou de faire partager des expériences doivent être mises en œuvre.
6. Le rôle central des enfants eux-mêmes. Les droits des enfants doivent être protégés. Le potentiel de développement de l'enfant propre à chaque âge doit être pris en compte. Agir avec les enfants va au-delà d'agir pour les enfants. Les enfants et l'ensemble des jeunes peuvent être des agents de changement en vue d'un développement durable. Les enfants peuvent également enseigner leurs familles et communautés de façon efficace.
- L'éducation doit considérer l'immense diversité de contextes et conditions de vie des êtres humains, qui sont souvent diminués et marginalisés (dans les bidonvilles et dans les villages pauvres), tout en valorisant la puissance de la solidarité et les opportunités présentes aussi bien dans la communauté scolaire que dans le contexte familial. Les communautés locales sont les espaces naturels où éducation formelle et informelle peuvent agir conjointement et mettre en œuvre des stratégies adaptées pour les jeunes et avec les jeunes.
7. Un nouveau rôle pour les scientifiques et les universitaires. La science et la technologie ont une place centrale, à la fois dans le diagnostic et pour fournir les moyens d'agir. Une étroite coopération est à rechercher entre les systèmes éducatifs et les communautés scientifiques, particulièrement dans les approches interdisciplinaires qui sont si essentielles pour enseigner le développement durable.
- Les expériences d'innovations dans l'éducation pour le développement doivent être systématiquement conçues, évaluées, amplifiées pour donner naissance à des changements d'échelle à partir d'exemples locaux. Beaucoup d'exemples de telles innovations ont été partagés pendant la Conférence.
- L’éducation doit être une combinaison entre des initiatives pratiques et une recherche soigneusement conçue ; par exemple l'amélioration de la santé et de l'hygiène dans des contextes de très bas revenus.
- La recherche sur le développement et les fonctions cérébrales doit s’amplifier et son lien avec l'éducation être mis en évidence.
8. Éthique et responsabilité. Pendant des millénaires, les sociétés ont été caractérisées par la division, la compétition et les rivalités. Les éducateurs doivent également mettre en avant les contextes dans lesquels l'histoire culturelle et sociale a su développer la recherche du bien commun, des rapports humains empathiques et des habitudes mentales ouvertes et souples, développant ainsi de nouveaux modèles de pensée capables de contrebalancer des croyances figées. Modifier l'attitude des humains et leur comportement envers la nature et envers les autres est aujourd'hui crucial. L'Encyclique Laudato Si’ appelle à une conversion écologique par l'éducation, qui reconnaisse la nécessité de changements de style de vie, de production et de consommation. Les systèmes éducatifs doivent prendre en compte les dimensions spirituelles de chaque personne, les notions de bien commun et la nécessité d'action locale pour un bien global.
- Les jeunes doivent être encouragés à respecter tout autre quel que soit sa race, sa culture ou sa religion et à établir un lien avec lui. Dans ce monde globalisé et interconnecté, ils doivent comprendre que l'absence de paix et de prospérité dans n'importe quel lieu lointain peut avoir des implications globales. Tout ceci requiert d'être fondé sur une vision éthique et morale.
- Enseigner des valeurs avec de solides fondements moraux doit être un élément de toute éducation visant au développement soutenable, même si les bonnes pratiques peuvent différer selon le contexte. Les écoles religieuses doivent se saisir de ces défis de la science et du développement durable, jouant ainsi un rôle important. La violence, la marginalisation et l'exclusion sont des échecs du développement durable.
[1] Globalization & Education (2005); Brain & Bread, Education and Poverty (2013); Sustainable Humanity, Sustainable Nature: Our Responsibility (2015)
[2] Lettre Encyclique Laudato Si’ du Pape François, Sur la sauvegarde de la maison commune, 24 Mai 2015
[3] UNESCO
[4] Data for 29 OECD countries, over the period 2003-2012. In PISA 2012 Results, OECD Publishing, Paris (2013).
Read Less